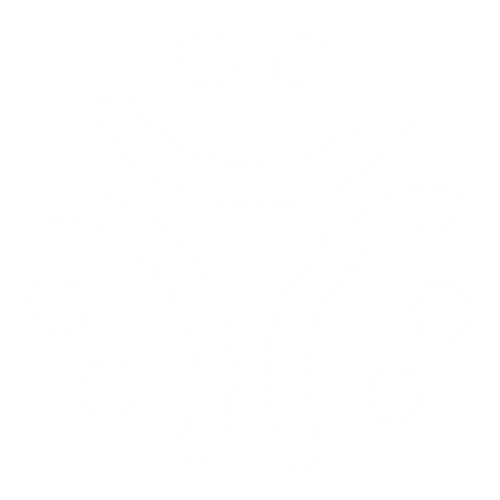Dans les crèches, la qualité de l’accueil repose sur les compétences des professionnels, leurs connaissances, leur posture, mais aussi — et surtout — sur la cohésion, la communication et le bien-être de l’équipe.
Or, dans certaines situations, ce n’est pas d’analyse de la pratique dont l’équipe a d’abord besoin, mais de régulation.
Régulation ou analyse de la pratique : comment faire la différence ?
L’analyse de la pratique est aujourd’hui bien ancrée dans les établissements petite enfance. Depuis la réforme des modes d’accueil entrée en vigueur en septembre 2021, elle est devenue obligatoire, conformément au décret n° 2021-1131 du 30 août 2021. Elle offre aux professionnel·les un espace pour prendre du recul, questionner leurs postures et faire évoluer leurs pratiques en s’appuyant, notamment, sur l’intelligence collective.
Mais pour que cette réflexivité soit réellement porteuse, encore faut-il que les bases relationnelles soient solides. Lorsque le cadre manque de clarté, que le projet pédagogique est flou ou que la dynamique d’équipe est fragilisée, l’analyse de la pratique peut vite s’essouffler. Les échanges tournent en rond, la parole se fige dans une plainte répétitive, et le processus perd de son sens. Ce risque est bien réel, et il mérite d’être pleinement pris en compte.
Lancer des séances d’analyse de la pratique suppose que certaines règles d’hygiène relationnelle soient déjà posées : une écoute bienveillante, le respect du cadre, une confiance mutuelle au sein de l’équipe, l’envie de collaborer, une compréhension partagée du projet pédagogique, et le sentiment d’être déjà entendu et soutenu dans son quotidien professionnel. Et, parfois, c’est là que le bât blesse…
La régulation d’équipe : un levier souvent sous-estimé
À l’inverse, la régulation d’équipe, bien que moins connue dans le secteur de la petite enfance, répond spécifiquement à ces enjeux de cohésion, de communication et de gestion des tensions.
Elle permet aux professionnels :
- de clarifier les malentendus,
- d’oser dire ce qui dérange dans un cadre sécurisé,
- de construire ensemble des règles de fonctionnement,
- de métacommuniquer, c’est-à-dire de parler de la façon dont les équipes communiquent,
- et de restaurer un climat de coopération sur le terrain.
Travailler le bien-être de l’équipe, c’est aussi (re)donner du souffle à la dynamique collective et à la qualité d’accueil des enfants. Car les enfants perçoivent tout : les tensions, les non-dits, le climat émotionnel. Cela se manifeste souvent par de l’agitation, de l’opposition ou un mal-être diffus.
En tant que responsable, comment savoir par quoi commencer ?
En tant que directeur/ directrice de crèche, ou responsable technique, vous pouvez vous poser cette question :
« Dois-je proposer une régulation d’équipe ou une analyse de la pratique ? »
Certaines observations sur le terrain peuvent vous aider à y voir plus clair :
- L’équipe a-t-elle connu beaucoup de changements récemment ? (turn-over, réorganisations, arrêts maladie, nouveaux arrivants…)
- Y a-t-il des tensions persistantes, parfois latentes mais visibles ?
- Les professionnels expriment-ils surtout le besoin de se plaindre, de décharger, plutôt que de réfléchir à leur posture ?
- Observez-vous déjà une difficulté à se mettre en mouvement en réunion, à questionner ses pratiques ?
- Des difficultés de communication entre la direction et l’équipe sont-elles perceptibles ?
- Un duo de collègues en conflit perturbe-t-il l’équilibre collectif ?
Dans ces cas, il est souvent plus pertinent de commencer par des temps de régulation. Ils permettront de remettre du lien, du sens, de la sécurité, et de restaurer un socle relationnel.
Un échange en amont avec un intervenant qui a les deux casquettes (régulation + analyse de la pratique) vous permettra de poser un diagnostic fin, et d’adapter au mieux l’accompagnement proposé.
L’analyse de la pratique ne doit pas devenir un outil de pilotage
Il arrive que la direction place beaucoup d’attentes dans l’analyse de la pratique, en espérant qu’elle fasse évoluer certaines postures qui questionnent. Ces intentions sont légitimes — et parfois très justes. Mais l’analyse de la pratique n’est pas un outil de pilotage. Elle ne peut porter ses fruits que si les équipes sont réellement libres de choisir les situations qu’elles souhaitent explorer, dans un cadre clair, confidentiel et sécurisé.
Plutôt que d’espérer que l’ADP oriente discrètement l’équipe vers une direction prédéfinie — même si la direction dispose souvent d’une vision fine des ajustements nécessaires —, mieux vaut nommer ces objectifs en réunion d’équipe ou dans le cadre d’une formation explicitement dédiée. L’analyse de la pratique, elle, est un espace à part : un temps de recul, sans injonction de résultat, où chacun peut réfléchir, ressentir, interroger, proposer. C’est précisément cette liberté qui rend le changement possible.
Conclusion
Régulation d’équipe et analyse de la pratique ne s’opposent pas. Ce sont deux outils complémentaires.
Mais dans certaines situations, commencer par réguler les tensions permet d’ouvrir ensuite, plus sereinement, un espace d’analyse de la pratique fécond.
L’auteure
Charlotte Pouyet est psychopraticienne, formatrice spécialisée dans la petite enfance, intervenante en analyse de la pratique et en régulation d’équipe. Elle est titulaire d’un Bac +5 en communication interne et management de la communication, et certifiée en pilotage de l’efficacité collective.