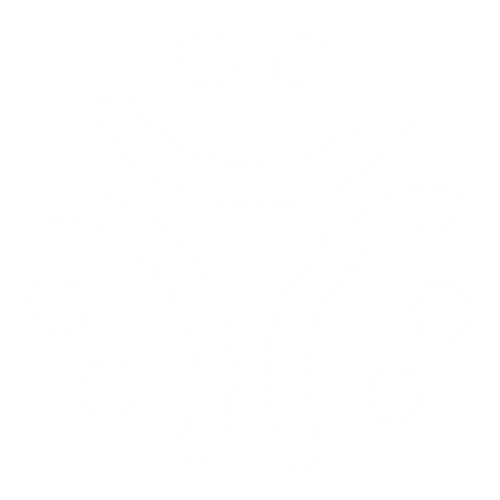Au fil des siècles, la vision de l’enfant a profondément évolué. Du Moyen Âge, où il était perçu comme un être impulsif à contrôler, jusqu’à aujourd’hui, où l’on valorise son épanouissement et son bien-être, notre regard sur l’éducation a été façonné par les connaissances scientifiques, les avancées législatives et les transformations sociétales.
La parentalité positive s’inscrit dans cette évolution. Fondée sur la bienveillance, l’accompagnement respectueux et le refus de toute forme de violence éducative, elle s’appuie sur de nombreuses recherches démontrant ses bénéfices sur le développement émotionnel, cognitif et relationnel de l’enfant. Son essor a permis une meilleure formation des professionnels, une promotion active des droits de l’enfant et un enrichissement des connaissances parentales. Pourtant, malgré ces avancées, un constat s’impose : l’épuisement parental n’a jamais été aussi présent.
Quand la parentalité positive devient une injonction
L’essor de la parentalité positive a généré un foisonnement de contenus pédagogiques, d’ouvrages et d’études scientifiques relayés par les médias et les réseaux sociaux. Pourtant, cette vulgarisation, si précieuse soit-elle, a parfois conduit à une rigidification des principes éducatifs. Les parents se retrouvent face à un ensemble de recommandations qui, plutôt que de les rassurer, peuvent les plonger dans un doute permanent :
- Ai-je bien réagi ?
- Suis-je un bon parent ?
- N’ai-je pas blessé mon enfant en disant cela ?
Le risque ? Une parentalité sous pression, où chaque geste, chaque mot, devient sujet à questionnement, au détriment du bon sens et de la spontanéité.
L’hyperparentalité : une dérive insidieuse
Dans cette quête du « meilleur pour son enfant », deux tendances émergent :
- La surprotection
Vouloir éviter à son enfant toute frustration, tout échec, toute difficulté. Résultat : une anxiété grandissante, une difficulté à affronter les défis du quotidien, une moindre tolérance à la frustration. - L’optimisation à outrance
Chercher à maximiser chaque potentiel de l’enfant : éveil intellectuel, compétences sociales, activités artistiques et sportives… Une stimulation excessive qui, à terme, peut générer stress et perfectionnisme, tant chez l’enfant que chez le parent.
Pourquoi ces dérives ?
Plusieurs facteurs expliquent ces glissements :
- Une mauvaise interprétation des concepts : Les termes « violences éducatives ordinaires » ou « parentalité bienveillante » sont parfois mal compris, donnant lieu à des craintes excessives.
- Une interprétation des études scientifiques : Si la recherche en psychologie infantile apporte des repères essentiels, elle ne doit pas être perçue comme une vérité absolue. Il n’existe pas UNE seule façon d’être parent. Chaque famille, chaque enfant, chaque relation est unique.
- L’illusion du contrôle total : Nous ne sommes qu’une partie de l’équation. Les enfants se construisent aussi à travers leurs propres expériences, leurs tempéraments, leurs interactions extérieures.
Parentalité positive : un guide, pas un dogme
Plutôt que de voir la parentalité positive comme une cible à atteindre parfaitement, considérons-la comme un phare. Un repère lumineux qui nous oriente sans nous contraindre. Car être parent, c’est aussi faire des erreurs, tâtonner, ajuster.
L’essentiel ? Sortir de la culpabilité, retrouver confiance en ses compétences parentales et accepter que l’éducation ne repose pas sur des recettes toutes faites, mais sur une relation en perpétuelle évolution.
La parentalité n’est pas un programme à exécuter à la lettre, mais une dynamique à construire avec ce que nous sommes, dans l’imperfection et l’authenticité.
Vous souhaitez proposer un café des parents sur la thématique de l’hyperparentalité ? contactez moi au 07 56 93 74 37 ou à contact@charlottepouyet.fr